Soigner les morts pour guérir les vivants / Magali Molinié
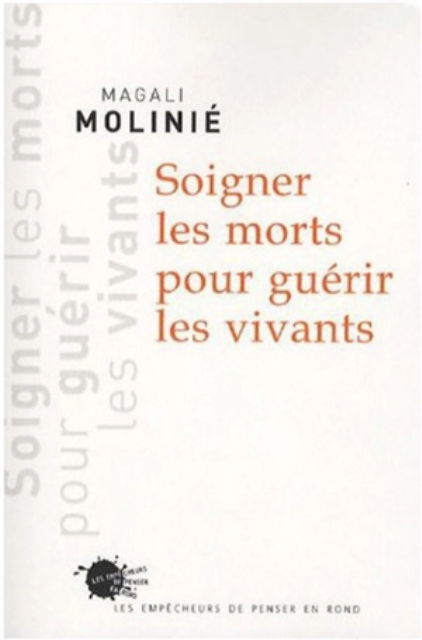
Soigner les morts pour guérir les vivants / Magali Molinié
Les empêcheurs de penser en rond, 2006, 329 p.
# Essai
Extrait
A l’issue de pratiques funéraires normatives – quand bien même leurs acteurs visent avant tout l’hommage individualisé et intime au défunt, le destin le plus courant des morts ordinaires, c’est bien d’être envoyé dans l’invisible, qu’il s’agisse du ad patrès romain, du royaume des ombres grecs, du gan eden juif, de l’au-delà chrétien, du bardo tibétain ou de quelque proposition new-age. Je crois qu’il n’y a pas de problème à identifier ces lieux comme des lieux culturels, spécifiques à un groupe, mais il y en a un, d’ordre méthodologique, à les assimiler, au nom d’une position savante qui n’envisage que le néant après la mort, à de simples croyances. La mort comme ouvrant seulement au néant est certainement la conception la plus minoritaire du monde.
Présentation
Cet ouvrage fait suite à une thèse soutenue par Magali Molinié sous la direction de Thobie Nathan, fondateur du centre d’ethnopsychiatrie clinique Georges Devreux.
Magali Molinié s’efforce de répondre à des questions relatives à la psychopathologie du deuil en se basant sur ce que les vivants disent, après la période de deuil, à propos de leur relation avec les morts. Elle accorde une importance particulière à ces derniers qui, selon elle, ont un statut, un sort, un rôle, une intentionnalité. Ce sont des êtres façonnés par un groupe culturel, des êtres sociaux construits par les rites, et non de simples figures du passé dont le vivant doit se détacher. Chaque société accorde une place aux morts en fonction de critères qu’elle privilégie : religion, force d’un évènement à caractère collectif (guerre par exemple), importance accordée à la vie affective des individus…
Cette psychologue clinicienne propose une vision élargie du deuil : outre sa dimension intrapsychique, il est construit et cadré par la culture du groupe d’appartenance. Il transforme l’endeuillé, le défunt et la relation qui les relie. Ce lien est identifié à partir du vécu intime du vivant (sensations, conceptions…) et du contexte (social et culturel) qui lui donne naissance. L’endeuillé est donc perçu comme un acteur de la transformation du défunt et de la relation avec lui, un expérimentateur de solutions et non plus uniquement comme subissant des processus intrapsychiques. Le psychologue se doit d’en tenir compte et de réfléchir comme s’il se trouvait dans une situation transculturelle.
S’appuyant sur des témoignages et des travaux de sociologie relatifs aux rites funéraires, l’auteure de cet ouvrage prône de s’intéresser autant à la place et au rôle du mort qu’aux conséquences de la perte pour l’endeuillé. Elle affirme que les morts sont présents à leur manière, et dans la clinique, et dans la société.
Invitation à la lecture de Béatrice Forest , Psychologue clinicienne
